
|
Enfant, Gonzalo Mesa Allende était chez lui à la Moneda, la maison présidentielle. Sa grand-mère, dont il était très proche, y avait ses propres quartiers. Aujourd'hui, au milieu d'une foule anonyme, le jeune écrivain de 37 ans n'y est qu'un visiteur parmi d'autres. Aucun privilège.
Les mois et les années qui suivront seront tragiques pour la famille, les collaborateurs et les sympathisants d'Allende. Des centaines de milliers de personnes prendront le chemin de l'exil. Plus de 100 000 connaîtront la prison et la torture. Mais surtout, 3 000 personnes seront assassinées ou portées disparues.
Il n'y a pas que l'armée qui sort victorieuse de la confrontation avec le gouvernement. Toute une classe de gens, ceux que les réformes d'Allende touchaient de près, sont soulagés. On fête dans les salons cossus pendant que les prisons sont pleines et que la torture et les disparitions deviennent monnaie courante. Malgré la répression, les manifestations populaires contre le régime militaire s'intensifient. Dans les années 80, les fameuses protestas servent de prétexte pour relancer un nouveau cycle de répression. Le compte des morts et des disparus continue à monter. Sous la pression populaire, les militaires finissent par assouplir les règles. Dix ans après le coup d'État, on permet à certains exilés de rentrer au pays. En digne petit-fils de son illustre grand-père, aussitôt rentré, Gonzalo commence à militer pour le retour de la démocratie.
Le pardon est-il possible? Valparaiso est la perle de la côte chilienne. C'est dans cette ville portuaire qu'Augusto Pinochet a fait construire un nouveau parlement en 1989. Chaque année, le 21 mai, un défilé militaire marque l'ouverture de la session parlementaire. Les élus du peuple passant en revue les trois corps de l'armée : c'est toute une symbolique dans un pays où le bruit des bottes a dominé la scène politique pendant près de deux décennies! Cette année, la scène est encore plus émouvante. Sur le podium se tiennent deux femmes célèbres qui ont toutes deux perdu leur père lors du coup d'État : Isabella, fille de Salvador Allende, est présidente de la chambre des députés, et Michelle Bachelet, la fille du général Bachelet, est la nouvelle ministre de la Défense du Chili. Alberto Bachelet était un des rares généraux restés fidèles au président Allende au moment du coup d'État. Sa fille et lui seront tous deux emprisonnés quelques semaines après la prise du pouvoir par Pinochet. Le père, souffrant d'une faiblesse cardiaque, ne résistera pas à la torture. La fille, elle, trente ans plus tard, dirige les destinées des forces armées. Peut-on conclure qu'elle s'est réconciliée avec le passé? Peut-être, dans une certaine mesure. Mais de là à pardonner, c'est une toute autre chose.
Cet
incitatif, espère-t-on, aura pour effet de faire avancer
la justice. |
L'émission Zone Libre est diffusée sur les ondes de Radio-Canada le vendredi à 21 h et présentée en rediffusion sur les ondes de RDI le samedi à 23 h, le dimanche à 4 h et à 20h, ainsi que le lundi à 3 h.
|
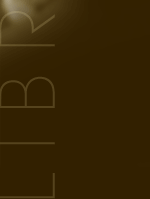
 LE
CHILI, TRENTE ANS PLUS TARD
LE
CHILI, TRENTE ANS PLUS TARD Pourtant,
pour Gonzalo, revenir à la Moneda, c'est replonger dans des
souvenirs tragiques. L'après-midi du 11 septembre 1973, dans
un palais attaqué de tous les côtés et malgré
les offres de sauf-conduit, son grand-père se suicide. La
Moneda est alors détruite et, avec elle, le rêve du
parti de l'Unité populaire. Aujourd'hui, à la Moneda,
il n'y a plus de traces de ces heures sombres de 1973. La junte
militaire de Pinochet, assermentée le jour même du
coup d'État, règnera sur le Chili pendant 17 ans.
Pourtant,
pour Gonzalo, revenir à la Moneda, c'est replonger dans des
souvenirs tragiques. L'après-midi du 11 septembre 1973, dans
un palais attaqué de tous les côtés et malgré
les offres de sauf-conduit, son grand-père se suicide. La
Moneda est alors détruite et, avec elle, le rêve du
parti de l'Unité populaire. Aujourd'hui, à la Moneda,
il n'y a plus de traces de ces heures sombres de 1973. La junte
militaire de Pinochet, assermentée le jour même du
coup d'État, règnera sur le Chili pendant 17 ans.
 Marco
Antonio, lui, n'a pas eu à fuir le Chili en 1973. Son nom
de famille est Pinochet. C'est le fils cadet du général.
Il a vécu ces années tout à fait différemment.
À 45 ans, il est aujourd'hui dans les affaires : immobilier,
import-export…
Marco
Antonio, lui, n'a pas eu à fuir le Chili en 1973. Son nom
de famille est Pinochet. C'est le fils cadet du général.
Il a vécu ces années tout à fait différemment.
À 45 ans, il est aujourd'hui dans les affaires : immobilier,
import-export…  En
1988, Augusto Pinochet, sous le feu croisé des pressions
populaires et internationales, décide de tenir un plébiscite.
Malgré
la peur qu'il inspire, le vieux général, trop sûr
de lui-même, perd son plébiscite. C'est le début
de la fin. En 1989 ont lieu les premières élections
libres. Le Chili en est aujourd'hui à son 3e gouvernement
démocratiquement élu. C'est le pays le plus prospère
et le plus stable du continent.
En
1988, Augusto Pinochet, sous le feu croisé des pressions
populaires et internationales, décide de tenir un plébiscite.
Malgré
la peur qu'il inspire, le vieux général, trop sûr
de lui-même, perd son plébiscite. C'est le début
de la fin. En 1989 ont lieu les premières élections
libres. Le Chili en est aujourd'hui à son 3e gouvernement
démocratiquement élu. C'est le pays le plus prospère
et le plus stable du continent.  « Vous
me demandez, lorsque je rencontre telle ou telle personne qui a
[participé au putsch], si je l'ai pardonnée? Je ne
pourrais pas dire que j'ai pardonné. Je dirais que j'ai rencontré
ce monde avec lequel j'étais en rupture profonde, et aujourd'hui
je travaille comme ministre de la Défense sans aucun problème
émotionnel. Bien sûr, j'ai mes douleurs à cause
de ce que j'ai vécu, parce que mes enfants n'ont pas de grand-père,
parce que ma mère est veuve, mais ce n'est pas contradictoire.
Mes douleurs m'ont servi. Au lieu d'avoir un sentiment négatif,
je me sers de ma douleur pour faire en sorte que personne, ni mes
enfants ni mes petits-enfants, ne passe par ce par quoi je suis
passée. J'essaie d'avoir une attitude constructive. Je n'ai
pas de contradiction. Je suis tranquille. » (Michelle
Bachelet)
« Vous
me demandez, lorsque je rencontre telle ou telle personne qui a
[participé au putsch], si je l'ai pardonnée? Je ne
pourrais pas dire que j'ai pardonné. Je dirais que j'ai rencontré
ce monde avec lequel j'étais en rupture profonde, et aujourd'hui
je travaille comme ministre de la Défense sans aucun problème
émotionnel. Bien sûr, j'ai mes douleurs à cause
de ce que j'ai vécu, parce que mes enfants n'ont pas de grand-père,
parce que ma mère est veuve, mais ce n'est pas contradictoire.
Mes douleurs m'ont servi. Au lieu d'avoir un sentiment négatif,
je me sers de ma douleur pour faire en sorte que personne, ni mes
enfants ni mes petits-enfants, ne passe par ce par quoi je suis
passée. J'essaie d'avoir une attitude constructive. Je n'ai
pas de contradiction. Je suis tranquille. » (Michelle
Bachelet) Un
nouveau jour se lève sur Santiago. Difficile de croire à
quel point cette capitale et ce pays moderne et prospère
sont encore aux prises avec les fantômes du passé.
En août 2003, le président Ricardo Lagos a fait une
proposition à la nation chilienne. Intitulée « pas
de demain sans hier », la proposition prévoit
des compensations pour les 100 000 victimes de torture, des
pensions doublées pour les familles des disparus et assassinés,
ainsi que des diminutions de peines pour les militaires qui n'ont
fait qu'exécuter les ordres.
Un
nouveau jour se lève sur Santiago. Difficile de croire à
quel point cette capitale et ce pays moderne et prospère
sont encore aux prises avec les fantômes du passé.
En août 2003, le président Ricardo Lagos a fait une
proposition à la nation chilienne. Intitulée « pas
de demain sans hier », la proposition prévoit
des compensations pour les 100 000 victimes de torture, des
pensions doublées pour les familles des disparus et assassinés,
ainsi que des diminutions de peines pour les militaires qui n'ont
fait qu'exécuter les ordres.