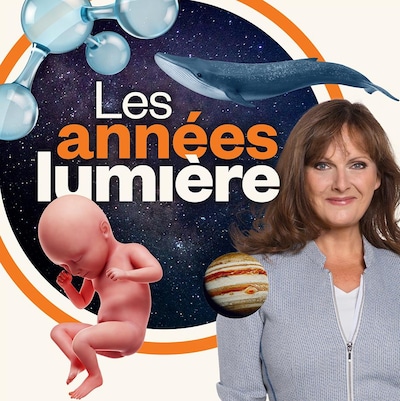Que ce soit pour protéger la biodiversité ou pour lutter contre les changements climatiques, l'importance de protéger les forêts d'Amazonie est un sujet régulièrement abordé. Il a fait les manchettes en 2019, après l'élection du président brésilien, Jair Bolsonaro, lequel promettait de réduire les restrictions sur l'exploitation forestière. Mais comme nous l'explique Alexandre Touchette, ce n'est pas le déboisement, mais plutôt la dégradation des forêts qui est la principale source d'émissions de carbone, selon deux études publiées dans Nature Climate Change.
Si la déforestation est facile à mesurer par imagerie satellite, la dégradation du couvert forestier l’est beaucoup moins. Ces perturbations peuvent être causées par l’humain, avec la coupe sélective des plus gros arbres, la fragmentation du territoire par les chemins forestiers ou encore l’agriculture sur brûlis. Cette dégradation a aussi des causes naturelles, comme les feux et les sécheresses prolongées, qui détruisent ou endommagent la végétation sur d’énormes superficies.
Les auteurs d'une étude publiée dans Nature Climate Change ont utilisé des satellites afin de mesurer les émissions de micro-ondes du sol et de quantifier la biomasse de la forêt amazonienne. Ils ont évalué que la déforestation comptait pour 30 % des émissions de carbone de l’Amazonie, tandis que la dégradation des forêts valait pour 70 %. Des émissions cachées qui font que l’Amazonie a émis 700 millions de tonnes de CO2 depuis 10 ans, basculant ainsi d’un rôle de puits de carbone à celui de source nette de carbone.
Dans une autre étude publiée dans la même revue, des chercheurs ont utilisé l’imagerie satellite et les données historiques sur les incendies de forêt pour calculer les variations de la biomasse hors sol dans 2,5 millions de kilomètres carrés de forêt couvrant l'Alaska, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. Leur conclusion est que la biomasse a augmenté légèrement depuis 30 ans, mais que les incendies de forêt ont réduit de moitié la capacité de stockage de carbone de la zone étudiée.