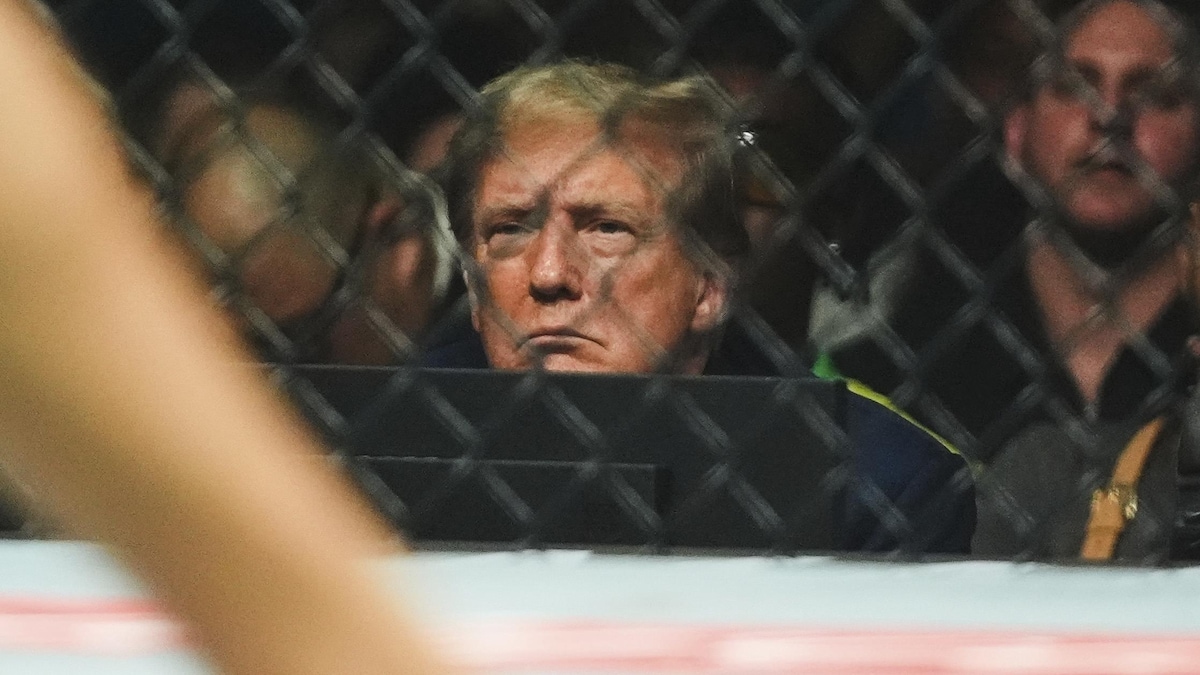Un steak carboneutre? Ce n’est pas pour demain
Depuis quelques années, des élevages québécois tentent de réduire leur empreinte carbone. C’est le cas dans la filière bovine, où le défi est particulièrement relevé parce que les ruminants produisent beaucoup de méthane.

Le troupeau d'Écobœuf compte une soixantaine de bouvillons.
Photo : Radio-Canada / Vincent Rességuier
La copropriétaire d'Écobœuf, Frédérique Lavallée, est persuadée qu’il est possible de produire un steak carboneutre : « c'est justement la mission qu'on s'est donnée », s’exclame-t-elle.
Il reste, pour y arriver, un problème de taille à régler et qui n’a rien de trivial : les rots.
Plus exactement, les renvois de la soixantaine de bouvillons qui composent le troupeau de sa ferme de recherche, située à La Sarre, en Abitibi-Témiscamingue.
Son partenaire, Simon Lafontaine, lui aussi agronome, évalue que plus de 60 % des émissions de la ferme proviennent de la fermentation entérique, c'est-à-dire la réaction chimique qui se produit lors de la digestion. Le processus de décomposition des aliments est à l’origine du méthane, un gaz plus polluant que le gaz carbonique.
Pas le choix, donc, de s’attaquer en priorité à l’alimentation des vaches. En offrant un pâturage de meilleure qualité et des plantes plus digestibles, on minimise ce phénomène
, affirme-t-il.

Les bouvillons de Frédérique Lavallée changent de parcelle deux fois par jour
Photo : Radio-Canada / Vincent Rességuier
C’est pourquoi les bovins sont nourris essentiellement à l'herbe de l'exploitation huit mois par an et avec du foin produit localement pendant l’hiver. Une pratique peu courante dans une industrie où les céréales sont souvent au menu, surtout dans les grandes exploitations.
En mangeant des grains, les vaches engraissent plus rapidement, mais elles ont des ballonnements, source de rots. Un paramètre, parmi d'autres, qui fait de la viande de bœuf la protéine la plus polluante à produire.
Une alimentation pour faciliter la digestion
Lors de notre passage chez Écoboeuf, à l'automne, les animaux broutent allègrement une herbe bien grasse. Une alimentation exclusive rendue possible par une gestion optimale des pâturages, explique Frédérique Lavallée, tout en guidant ses vaches, visiblement enthousiastes.
- Ailleurs sur info Selon Trump, une peine de prison pourrait être un « point de rupture » pour ses partisans
- Ailleurs sur info Élections américaines : « L’inquiétude ne nous sert pas », dit l’ambassadrice du Canada
- Ailleurs sur info Dix ans après la tuerie de Moncton, la GRC tarde à mettre en œuvre une recommandation
Elles ont hâte d'avoir un nouveau bar à salade
, lance l'agronome, dans un éclat de rire.
Deux fois par jour, elle déplace son troupeau vers une nouvelle parcelle. C’est pour s'assurer que les plantes ne soient pas trop abîmées et que la croissance continue année après année
, dit-elle.
Grâce à ce procédé, elle espère fournir à ses bovins une herbe plus digeste et, par conséquent, faire baisser les émissions de méthane.
En parallèle, elle espère aussi que ses parcelles vont améliorer la rétention du carbone dans le sol grâce aux racines des plantes qui peuvent aller en profondeur et qui investissent plus d'énergie dans leur croissance, mais moins dans leur survie
.
Pour capturer du carbone, elle fait aussi pousser des haies d'ombrage afin de protéger ses prairies. Une pratique qui a d'autres avantages, comme isoler l'herbe du froid ou la protéger en cas de fortes chaleurs. Peupliers hybrides, érables rouges et épinettes blanches, les propriétés de chaque essence sont finement analysées.
Mme Lavallée évalue les résultats dans le cadre de son doctorat en sylvopastoralisme à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Elle estime que cette méthode permettrait de séquestrer 9,13 tonnes de CO2 par hectare annuellement, sur une période de 40 ans.

Frédérique Lavallée et Simon Lafontaine dans les champs de la ferme de recherche Écobœuf à La Sarre, en Abitibi.
Photo : Radio-Canada / Vincent Rességuier
La gestion du fumier
Écoboeuf explore un autre levier pour réduire les émissions de gaz à effet de serre : la gestion du fumier. Simon Lafontaine veut implanter un procédé de biométhanisation qui est en cours de développement avec différents partenaires.
L’idée est d’utiliser ensuite le biogaz comme énergie pour le chauffage et, peut-être un jour, pour alimenter la machinerie agricole.
Il pense que son outil a le potentiel de réduire les émissions d'une ferme bovine typique de l'Abitibi d'environ 15 %, soit approximativement 300 tonnes d'équivalent CO2 annuellement
. Selon ses calculs, l'élevage d'un bœuf émet 9 tonnes d'équivalent CO2, principalement sous forme de méthane.
Il émet toutefois des réserves quant à la fiabilité des projections en général et soutient qu'il s'avère d'ailleurs difficile de faire un bilan exact des émissions de GES sur son exploitation. Les outils actuels ne sont pas assez précis à son goût.
M. Lafontaine est aussi professeur dans le domaine de la production bovine écoresponsable à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Il travaille justement sur le raffinement des méthodes de calcul des émissions en agriculture, qui sont compliquées et très variables
, selon les contextes. Des progrès sont en cours, mais c’est un effort de longue haleine
, conclut-il.

Stéphane Godbout dans les laboratoires de l'IRDA à Deschambault-Grondines
Photo : Radio-Canada / Vincent Rességuier
Cultiver ses données
L'ingénieur-chercheur Stéphane Godbout participe à cet effort. Il mène ses travaux dans le laboratoire de l'Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA), situé à Deschambault-Grondines, dans la région de Québec.
Il constate que les outils actuels proviennent surtout d’études européennes, ce qui a ses limites. Ce n'est pas le même climat, ce ne sont pas les mêmes types de sols, souligne-t-il. Toute la communauté scientifique et les producteurs de toutes les filières voudraient avoir les vraies valeurs d’ici. On avance, on apprend, mais il y a un coût. Ce n'est pas si facile.

Ce laboratoire de l'IRDA compte 12 chambres qui permettent de contrôler l'alimentation et les déjections des animaux.
Photo : Radio-Canada / Vincent Rességuier
Il mène des expériences en environnement contrôlé, avec de petites populations qui permettent d'obtenir des indicateurs pour les grandes exploitations pouvant accueillir des milliers d'animaux. Si j'ai 30 % de réduction en changeant un élément dans la moulée du porc, raconte-t-il, on sait par expérience que l'écart reste le même à grande échelle.
M. Godbout observe une amélioration progressive des pratiques dans différentes filières et estime que le secteur de l’agriculture pourrait atteindre une certaine forme de carboneutralité d’ici 15 ou 20 ans
.
Mais selon lui, il va être difficile pour chaque éleveur, ou même chaque cultivateur, de viser la carboneutralité en tout temps. L’objectif sera plutôt atteint de manière globale en faisant l’addition des différentes régions et des différentes filières au pays.
Pourquoi? En grande partie à cause d'éléments extérieurs, dont les conditions climatiques. Un été chaud peut plomber le bilan carbone d’une filière ou d’une région, mais être très positif ailleurs. C'est un peu comme la banque de carbone
, conclut-il, les efforts des uns compensent les excès des autres.

Stéphane Godbout, professeur associé au Département des sols et de génie agroalimentaire de l'Université Laval
Photo : Radio-Canada / Vincent Rességuier
Rentable, le steak carboneutre?
M. Godbout pense toutefois que ce sera plus difficile pour les élevages de ruminants, comme les bovins. Réduire les émissions de GES implique de modifier, voire de réduire l’alimentation. Or, cet élément joue inévitablement sur la qualité de la viande et le rendement.
Il est fort probable que les éleveurs de bonne volonté soient confrontés à des enjeux de rentabilité.
Malgré les défis, Simon Lafontaine entend multiplier les initiatives pour produire de la viande carboneutre, tout en soulignant qu’il faudra en consommer avec modération
. Une manière de dire que pour atteindre la carboneutralité, les consommateurs n’auront pas le choix de manger moins de viande et de la payer plus cher, parce qu’elle sera plus complexe à produire.