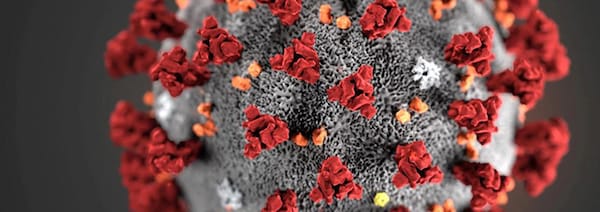La détresse des confinés, victimes collatérales de la pandémie

Près d'un an après le début de la pandémie, les effets du confinement continuent à se faire sentir et plusieurs indicateurs laissent entrevoir une sortie de pandémie dramatique pour les plus vulnérables.
Photo : iStock / Mixmike
Prenez note que cet article publié en 2021 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.
Les lendemains de la pandémie pourraient lever le voile sur une autre crise, celle de la santé mentale. Alors que la population est confinée, cette crise, plus sournoise, s'est installée derrière les portes closes. Violence familiale, toxicomanie, détresse psychologique : les problèmes sont nombreux et la prise en charge est de plus en plus difficile.
On est le bout de l'iceberg, mais quand le bout de l'iceberg est deux fois plus gros, ça indique que l'iceberg est beaucoup plus gros
, dit la pédopsychiatre Catherine Boucher entre deux consultations au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont à Moncton.

La pédopsychiatre Catherine Boucher explique que l'hospitalisation est une solution de dernier recours.
Photo : Catherine Boucher
Les patients de Catherine Boucher ont moins de 18 ans, ce sont des enfants et des adolescents. Au cours des dernières semaines, la pédopsychiatre a observé une explosion des admissions. L’unité opère à 350 % de sa capacité cette semaine et la semaine dernière c’était à 400 %, raconte la Dre Boucher, du jamais-vu depuis son arrivée à l’hôpital en 2003.
Ils sont tellement pas bien qu'ils ne sont plus capables de fonctionner, soit qu'ils ont des idées morbides ou des périodes de désespoir et de découragement.
La petite unité de deux chambres peine à suffire.
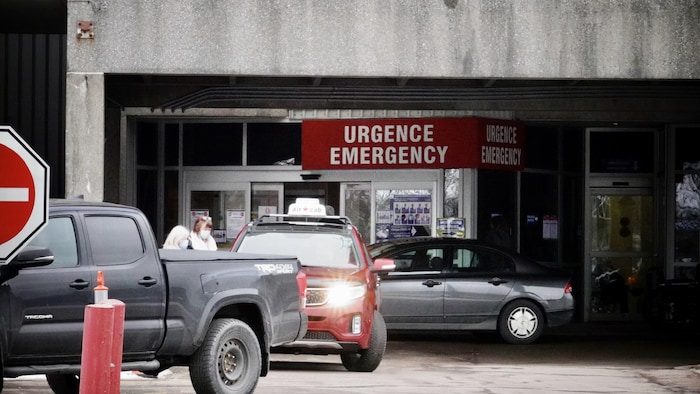
L'unité de pédopsychiatrie du CHU Dumont compte deux chambres. La Dr Boucher a vu jusqu'à 10 enfants être admis ces dernières semaines.
Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc
Dépendamment de la zone où on se trouve, rouge ou orange, il y a des services qui ne fonctionnent que par téléphone ou avec des effectifs réduits. Nous on est un peu le bout de l'entonnoir quand ces services sont moins présents, comme filet de sécurité dans les communautés. Ça nous donne plus de travail
, indique Catherine Boucher.
Selon la pédopsychiatre, le confinement et la pandémie ont fragilisé la santé mentale des enfants qui avaient déjà des problèmes d’anxiété, d’hypocondrie, de déficit d’attention et d’apprentissage. Ceux dont le système familial était déjà en difficulté avant la pandémie vont aujourd’hui beaucoup moins bien.
Le nombre de cas de COVID-19 n'a jamais été aussi élevé au Nouveau-Brunswick. La région d'Edmundston connaît même un deuxième confinement qui implique la fermeture des écoles.

L'école secondaire francophone Cité des Jeunes A.-M.-Sormany à Edmundston (ci-dessus) et l’école anglophone Edith Cavell à Moncton signalent chacune un cas de COVID-19.
Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel
Je pense qu'on peut s'attendre à plus de décrochage, parce qu'ils ne vont pas réussir aussi bien et ils vont se désengager et se démotiver. Il y en a qui font bien en ligne et il y en a qui ne réussissent pas bien
, indique Dr Boucher.
Je pense qu'il y aura des tragédies dans cette cohorte-là, des rêves et des carrières qui ne pourront pas être poursuivies.
D’ailleurs, on a noté une diminution des signalements des cas de maltraitance et de négligence aux Services de protection à l'enfance depuis le début de la pandémie au Nouveau-Brunswick.
Les intervenants ont cependant observé une hausse significative des signalements lors du retour des élèves sur les bancs d'école en septembre.
Davantage de violence dans les familles
Les enfants ne sont pas les seuls à porter les marques du confinement. Plusieurs indicateurs laissent entrevoir une sortie de pandémie dramatique pour les plus vulnérables.
En voyant le nombre de violences physiques qui augmente, la sévérité qui augmente, il y a une réelle crainte pour les femmes
, indique Geneviève Latour, agente d'élaboration des programmes à l’organisme Carrefour pour femmes, à Moncton.

Le refuge de l'organisme Carrefour pour femmes à Moncton doit refuser davantage de femmes depuis le début de la pandémie.
Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc
Les victimes de violence physique qui résident à la maison de transition de Carrefour pour femme, le plus important centre du genre dans la province, sont en constante augmentation. Elles représentaient 50 % des clientes du refuge avant la pandémie et elles sont aujourd’hui plus de 80 %.
Le refuge a même reconfiguré les espaces administratifs en chambres pour répondre à la demande tout en respectant les consignes sanitaires. Malgré tout, ce n'est pas suffisant. L’organisme a refusé une centaine de femmes en 2019 et ce nombre est en hausse depuis le début de la pandémie.

Geneviève Latour note une escalade de la violence physique envers les femmes et du niveau de gravité de la violence avec des armes.
Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes
Les femmes âgées de 30 à 44 ans fréquentent davantage le refuge depuis le début de la pandémie.
Les conditions d'isolement ont fait que ces femmes-là ne peuvent plus rester dans la relation abusive, ne peuvent plus se dire "une fois que les enfants s'en iront", "une fois que les enfants ne seront plus à l'école" et ont pris la décision de s'en aller
, dit-elle.
C'est là qu'on peut voir la goutte qui fait déborder le vase. Et de se dire "je ne suis plus en sécurité"
, note Geneviève Latour.
Traitement des dépendances : un tsunami à l’horizon
Dans les centres de réadaptation en toxicomanie, on s'attend aussi à un contrecoup après la pandémie.
On les a beaucoup oubliés dans cette pandémie, surtout les jeunes de 18 ans et plus qui font l'école en ligne depuis le mois de mars, donc c'est dur pour eux. Je pense que la santé mentale des jeunes en prend un coup
, dit Seychelle Harding, porte-parole de l'organisme Portage qui s’occupe de la réadaptation des jeunes toxicomanes.

Le Centre Portage Atlantique à Cassidy Lake au Nouveau-Brunswick.
Photo : Radio-Canada
Bien que l’organisme observe une baisse dans les signalements dans son centre du Nouveau-Brunswick, qui accueille des jeunes de 14 à 21 ans, Seychelle Harding n'y voit pas une bonne nouvelle, bien au contraire.
On observe une légère baisse de nos appels qui peut être expliquée par le fait que les élèves sont à l'école ou à la maison une journée sur deux. Les professionnels qui s'occupent des jeunes en difficulté travaillent de la maison ou font une rotation entre plusieurs écoles et les jeunes tombent un petit peu entre les mailles du système en ce moment.

La porte-parole de l'organisme Portage, Seychelle Harding, croit que les conséquences de la pandémie chez les jeunes se feront sentir pendant de longues années.
Photo : Radio-Canada
Les lendemains de la pandémie pourraient bien lever le voile sur une réalité bien plus sombre que ce que disent les chiffres aujourd'hui.
Nos jeunes qui sont qui sont en démarche de thérapie dans un de nos centres au Québec ou en Ontario consomment encore, aujourd'hui même encore plus avec tous les problèmes d'anxiété et de dépression que la COVID apporte. Je pense qu'on va malheureusement voir les conséquences un peu plus tard
, indique Seychelle Harding.
L’école à la maison, un choix déchirant
Le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick, Dominic Cardy, reconnaît que la décision de maintenir l'apprentissage à la maison pour une partie des élèves a des conséquences sur leur santé mentale.
C'est un choix terrible chaque jour. C'est lourd d'avoir ce poids sur mes épaules et tout le personnel enseignant dans le système.
Chaque jour de COVID-19, c'est un choix entre endommager la santé des jeunes et des équipes scolaires avec des éclosions d'un côté et de l'autre. Qu'est-ce qui va se passer à l'extérieur de l'école, avec l'augmentation des crises de santé mentale. C'est quelque chose qui me préoccupe
, fait valoir Dominic Cardy.

Dominic Cardy a pris la décision de fermer les écoles de la zone 4 (Edmundston, Grand-Sault) en raison des nombreux cas de COVID-19. C'est la seule région qui a vu tous ses établissements scolaires fermer depuis le confinement du printemps.
Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach
Et le système qui récupère ces victimes collatérales de la pandémie commence à montrer des signes de fatigue.
On est une équipe de 14 cliniciens, et il y en a quatre qui sont en congé maladie dernièrement. C'est difficile de travailler dans ce contexte-là
, indique la pédopsychiatre Catherine Boucher.
Ça met en lumière comment le système était déjà étiré à son maximum et sous-financé, et là on ajoute un stress supplémentaire et le système n'arrive pas à fournir
, conclut-elle.