Pour une politique culturelle québécoise qui reconnaisse les Autochtones
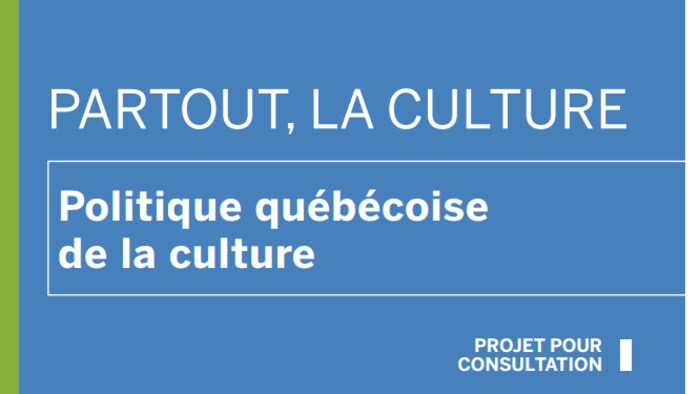
Partout, la culture
Photo : Gracieuseté
Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.
Nadine St-Louis est fondatrice et directrice générale des Productions Feux Sacrés. Elle travaille dans le domaine de la culture autochtone depuis une vingtaine d'années. Elle réagit au document sur le renouvellement de la politique culturelle du Québec, qu'elle qualifie de « point tournant dans l'histoire du Québec qui facilitera l'inclusion et amènera une réconciliation culturelle vivante ».
Par Nadine St-Louis
En tant qu’entrepreneure autochtone engagée depuis 20 ans à promouvoir nos cultures, j’ai été honorée d’avoir été choisie pour faire partie du comité-conseil et d’amener à la table les enjeux et les défis des Autochtones afin de contribuer au développement culturel au Québec inclusif « PARTOUT, LA CULTURE ». Je voulais partager mes impressions par rapport au renouvellement de la politique culturelle du Québec.
Le ministre de la Culture et des Communications et son équipe du renouvellement de la politique culturelle ont fait un travail extraordinaire à deux niveaux. D’abord pour moderniser la vision culturelle du Québec afin qu’elle reflète notre société en constante évolution. Deuxièmement, une attention particulière a été accordée aux nations autochtones du Québec, jusqu’ici invisibles dans les politiques du passé. Le ministre a rencontré les chefs et les artistes autochtones lors de deux rencontres, afin de les entendre sur ce qui, selon eux, devrait être intégré dans la politique pour démontrer le respect et la reconnaissance des cultures des Premières Nations et des Inuits.
Les quatre orientations de la politique sont ancrées dans un développement durable et inclusif qui démontre une volonté du gouvernement d’assurer une action culturelle transversale.
Le gouvernement a consacré dès le départ le premier chapitre aux Autochtones et apporte pour une première fois dans une politique culturelle québécoise des engagements concrets envers la préservation des langues autochtones, le soutien des pratiques artistiques coutumières et contemporaines des Autochtones et le rayonnement de la culture au Québec, au Canada et à l’international.
Il est clair que la nouvelle politique fait place à l’importance de la contribution des Autochtones au dynamisme culturel du Québec. Bien sûr, cette reconnaissance et ce respect de la culture et de l’histoire autochtones impliquent un redressement historique d’importance et revêtent un caractère déterminant pour l’avenir.
Ce n’est pas une admission facile pour les peuples colonisateurs et le redressement implique des défis de taille. Mais c’est aussi une opportunité sans précédent de réécrire l’histoire et de tracer un avenir prometteur et humaniste pour les générations futures d’ici.
Je vois la nouvelle politique comme un point tournant dans l’histoire du Québec qui facilitera l’inclusion et amènera une réconciliation culturelle vivante. Le plan d’action va déterminer comment nous allons avancer dans un environnement propice à la création et à la diffusion pour un rayonnement des artistes et des cultures autochtones sur tous les territoires. Les principes de bases sont établis, mais il faut maintenant mettre en place les mécanismes et les ressources nécessaires pour concrétiser ses principes.
Il était grand temps d’éliminer les écarts sociaux, l’isolement et la marginalisation des voix autochtones pour arriver à une société équitable et inclusive.
Je crois que le redressement des inégalités était nécessaire pour modifier les structures et reconnaître l’art et la culture autochtones et je crois aussi que l’équipe du ministre de la Culture et des Communications a fait ce travail.
L’art traditionnel autochtone, avec ses techniques et ses symboliques riches d’enseignements, prend ses sources dans le lien indissociable entre l’humain et la Terre d’ici. Il est le seul né de ce territoire et il n’existe nulle part ailleurs. Notre « apprentissage » et notre perception de l’histoire proviennent d’un enseignement qui couvre moins de 500 ans. Il serait heureux que les générations futures puissent apprendre et reconnaître que la présence et l’évolution humaine sur ce territoire sont plusieurs fois millénaires et que d’autres communautés y ont tracé leur chemin et y ont vécu avant nous et qu’à bien des niveaux notre survie sur ce territoire provient de leur enseignement.
Avec la Commission de vérité et réconciliation, nous avons tous notre part de responsabilité à comprendre les torts causés au cours de notre histoire, l'absence de représentation et le bâillonnement des voix.
Les peuples autochtones du Canada ont été soumis au colonialisme — une pratique de domination qui consiste en l'assujettissement d'un peuple à un autre. Il ne faut pas oublier que les répercussions sur les langues, les arts, la culture et l'économie autochtones, engendrées par le processus de colonisation, sont profondes et durables. La colonisation avait pour but de couper les peuples autochtones de leurs terres, de leurs langues, de leur identité, de leurs connaissances, de leurs traditions et de leurs pratiques.
Il aura fallu dix ans au Canada pour adopter, sans restriction, la Convention sur les droits des peuples autochtones de l’ONU. Choisissons l’espoir pour la suite des choses, en croyant fermement que les populations des différentes communautés qui vivent désormais ici sauront recréer des rapports basés sur le respect et la reconnaissance des différentes traditions culturelles qui enrichissent notre société. Peut-être alors les jeunes générations pourront-elles porter avec plus de justesse la devise du « Je me souviens ».
En solidarité avec nos communautés,
Nadine St-Louis, fondatrice et directrice générale des Productions Feux Sacrés








