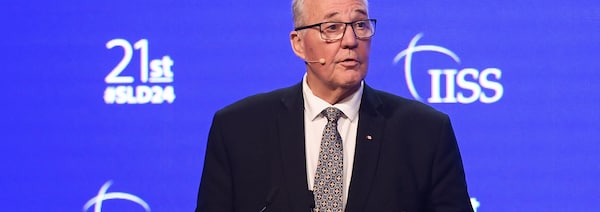ChroniqueVoter quand on y trouve peu d’intérêt

Depuis 2006, la population autochtone a augmenté de 42,5 %, ce qui représente plus de quatre fois le taux de croissance de la population non autochtone au cours de la même période. Et la plupart habitent en ville.
Photo : Getty Images / Jemal Countess
Prenez note que cet article publié en 2019 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.
Prendre connaissance de l’histoire du droit de vote au Canada, c’est aussi revisiter un Canada sexiste, discriminatoire et raciste. C’est particulièrement vrai pour les Autochtones.
Un jour, dans le cadre d’une recherche universitaire, j’ai eu à recenser les dates percutantes sur les relations entre les Autochtones et Ottawa. Parmi tous les courants d’encadrement paternalistes auxquels nous avons été confrontés, notre historique au sujet du droit de vote reste assez extraordinaire.
Cyndy Wylde est une Autochtone, doctorante et chargée de cours à l'UQAT. À intervalles réguliers, Cyndy publie dans les pages d'Espaces autochtones de Radio-Canada ses analyses, ses coups de cœur, mais aussi ses critiques.
L’histoire du droit de vote au Canada pour les Autochtones : un parcours ardu
Tout d’abord, si vous faites une toute petite recherche sur internet, vous apprendrez que nous avions jadis le « droit » de vote à partir de la Confédération. Je me permets de mettre « droit » entre guillemets puisque je suis loin d’être certaine qu’il s’agissait d’un « droit ».
Dans les faits, pour exercer ce « droit », nous devions renoncer à ce que nous étions. Renoncer à notre statut d’Indien. Oui, « émancipation » obligatoire! C’était une belle clause prévue dans la Loi sur les Indiens! Alors quand on me dit qu’à cette époque, les Autochtones avaient le « droit » de vote… on peut en jaser longtemps!
Il y a eu aussi l’époque où les Autochtones ont servi dans l’armée canadienne. Même si à un moment donné, la Loi sur les élections en temps de guerre accordait le droit de vote aux femmes dont le mari ou le fils servait à la guerre, cette même loi excluait les femmes autochtones.
En 1917, la Loi des électeurs militaires est promulguée. Elle accorde le droit de vote aux Autochtones qui sont soldats, et cela, sans perdre leur statut d’indien.
En mai 1918, le droit de vote est finalement accordé à la majorité des femmes du Canada, sauf à celles d’origine asiatique et aux femmes autochtones. Pour les femmes autochtones, on assiste à une continuité de droits brimés, mais pour les femmes d’origine asiatiqus? Je m’explique mal sur quelle logique reposent ces décisions.
Les Inuit obtiennent pour leur part le droit de vote en 1950. Ce droit sera peu exercé parce qu’à cette époque, les boîtes de scrutin ne se rendaient pas ou arrivaient très en retard dans le Grand Nord. Certains écrits nous indiquent que les urnes électorales ne se sont en fait rendues qu’une douzaine d’années plus tard après avoir obtenu le droit de vote. Donc, droit de vote sans possibilité réelle de voter.
L’ouverture du gouvernement fédéral surviendra en 1960. Le 31 mars de cette année-là, la Loi électorale est abrogée afin de permettre aux « Indiens inscrits » de voter, et ce, sans compromettre leur statut.
Qu’à cela ne tienne, la province dans laquelle je vis quant à elle tardera. Le Québec deviendra le 2 mai 1969, la dernière province, oui exactement la dernière, à accepter que les Autochtones votent aux élections provinciales. Nous les Autochtones avons eu le droit de voter au Québec après les autres femmes du pays entier. Si cela n’est pas raciste et discriminatoire, qu’on m’explique svp!
Un intérêt mitigé
Pourtant, pour une majorité d’Autochtones, même si les droits démocratiques s’appliquent aussi à eux, une question s’impose. Sont-ils utiles? Si oui, à qui?
La campagne électorale québécoise de l’année dernière m’a très peu interpellée. Même chose pour la présente campagne électorale fédérale. Pourquoi? Parce que même si je trouve importants certains engagements, par exemple tous ceux qui concernent la protection de l’environnement, je ne me sens que très peu interpellée comme femme autochtone par les enjeux débattus.
Pourtant, le dernier mandat du gouvernement Trudeau a eu au moins comme conséquence de mieux faire connaître les enjeux autochtones. Nos nombreux enjeux pour dire vrai. Peut-être trop? À vrai dire, je ne sais pas quoi penser; le parti libéral se fait très discret sur ses engagements envers les Autochtones dans sa campagne actuelle.
Les conservateurs, on le sait, ne sont pas nos alliés. Quant aux libéraux, même s’ils ont défendu vigoureusement en 2015 un programme dirigé vers les Autochtones, on ne sait trop non plus s’ils sont toujours nos alliés.
Ceci dit, deux partis politiques se sont lancés avec de beaux engagements : le parti Vert et le NPD. Malgré des promesses électorales très positives qui touchent les Autochtones, une partie de leur programme demeure dans le brouillard.
Quant à mon entourage, je ne ressens pas vraiment d’adhésion ou de sentiment d’appartenance envers un parti en particulier. Les communautés autochtones du Québec sont distinctes à bien des égards du reste du Canada et je me demande à quel point les Autochtones d’ici se sentent interpellés par leur programme.
Le droit de vote accordé aux Autochtones de ce pays m’apparaît comme un mal nécessaire du point de vue de l’État canadien. Il a été accordé au gré des droits revisités, mais toujours encadré de façon générale par la Loi sur les Indiens. À force d’éliminer quelques discriminations, on a abouti à pouvoir voter. Mais pour qui? Pourquoi?
J’ai beau lire les programmes des différents partis, je ne trouve pas pour qui voter et pourquoi voter. Est-ce qu’il y a un parti parmi ceux qui se présentent actuellement en vue des élections du 21 octobre qui réussira à se démarquer en se collant à nos besoins et priorités? Avec un peu de volonté, il est pourtant facile de se mettre au fait.
L’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador souligne sans arrêt et avec acharnement ce qui représente pour nous des enjeux incontournables: la sécurité des femmes autochtones, la protection et la reconnaissance de nos droits sur nos territoires, la nécessaire autonomie gouvernementale. Pourtant, on fait peu de cas de ces enjeux dans les programmes des partis.
Il y a encore une possibilité d’améliorer le taux de participation des électeurs autochtones. Il faut juste saisir où sont nos intérêts et connaître nos motivations. Je commence vraiment à croire qu’il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir.
Parallèlement, nous, les Autochtones, nous voulons que nos formes traditionnelles de gouvernance soient reconnues et respectées. Un constat qui signifie qu’on a du travail à faire.
En fait, ne devons-nous pas repenser, en tant qu’Autochtones, notre façon de prendre part aux différents mouvements politiques de ce pays?