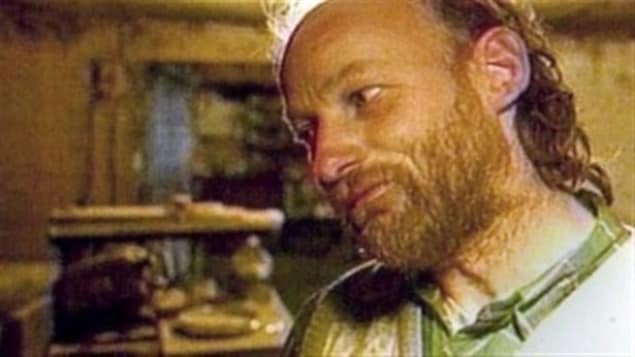- Accueil
- Société
- Engagement communautaire
Une complicité mère-fille au service des femmes autochtones

Nathalie et Pénélope Guay, la fille et sa mère, sont toutes les deux directrices de la maison communautaire Missinak.
Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

On entre à la maison Missinak comme si on visitait grand-maman. À peine passé le pas de la porte, on fait déjà partie de la famille. L’accolade est immédiate. « Viens goûter à ce que Doris* a cuisiné, c’est écœurant! » Les rires envahissent la maison, les enfants courent un peu partout, les adultes sont attablés autour d’un bon repas. L’endroit respire l’amour et la tendresse. C’est ce qu’ont bâti Pénélope Guay et sa fille Nathalie.
Pourtant, le lieu n’a rien de particulièrement réjouissant de prime abord. Il s’agit d’un centre d'hébergement pour femmes autochtones victimes de violences. Le seul à Québec et dont les services sont suprarégionaux. Le parcours des deux femmes ainsi que leur complicité hors pair ont permis d’aider des centaines de femmes et leurs enfants depuis plus de 20 ans.
Selon elles, leur plus grande force, c’est de s’avoir l’une et l’autre.

Pénélope et Nathalie Guay, en compagnie de Nathalie et Audrey.
Photo : Radio-Canada / Magalie Masson
Pour plusieurs femmes hébergées, Pénélope et Nathalie sont « kukum » [grand-mère] et maman
. Elles incarnent une présence maternelle que certaines n’ont jamais connue. Elles écoutent, réconfortent et complimentent, tout en prônant l’autonomie, la détermination et le courage.
Je me sens accompagnée avec ces femmes-là. Je retrouve ma force intérieure, la flamme que j’avais qui commençait à s’éteindre. Elles rallument le feu intérieur, je crois
, confie Audrey.
On peut être nous-mêmes. On peut avoir confiance en nous. Elles nous donnent toujours le coup de pied aux fesses pour qu’on ait confiance en nous. Si elles n’avaient pas été là, je ne sais pas où je serais rendue
, ajoute Nathalie.
Lors de notre visite, Audrey et Nathalie en étaient à leur deuxième passage à la maison Missinak. Elles connaissent la famille Guay depuis près de dix ans. Pénélope et Nathalie les ont aidées, même lorsqu’elles n’étaient plus à la résidence.

Trois femmes sont assises autour d'une table et lisent des cartes sur la croissance personnelle.
Photo : Radio-Canada / Magalie Masson
Ensemble, Pénélope et Nathalie ont créé la maison Missinak, un site de ressourcement sur la Côte-de-Beaupré et, tout récemment, la première ressource de deuxième étape pour femmes autochtones victimes de violences de la province.
Ça a été notre chemin de vie de travailler avec des humains
, dit avec humilité Pénélope Guay.
Sa fille Nathalie, aînée de quatre enfants, se souvient des projets dans lesquels s'impliquait la famille lorsqu’elle était plus jeune.
Je me souviens quand j’étais jeune, maman était impliquée dans le Regroupement pour le développement social (RPDS) à Roberval avec les personnes assistées sociales. Avec le groupe Guatemala aussi, on faisait des toutous avec des chiffons pour qu’elle apporte ça là-bas. On faisait des bazars avec les outils de la paix dans le temps. On a été élevées, imprégnées dans tout ce qui était communautaire, donc on n’en sort pas
, raconte Nathalie.

Pénélope Guay, dans la vingtaine. (Photo d'archives)
Photo : Archives personnelles de Pénélope Guay
Mais avant d’aider, la famille a aussi connu des périodes plus sombres. Pendant huit ans, j’ai vécu de la violence, toutes les sortes de violences. À 25 ans, j'ai mis mon pied à terre, j'ai cassé avec mon ex-conjoint. Jusqu’à 28 ans, j'ai beaucoup consommé. Je n'étais pas fière de moi
, confie Pénélope Guay.
Il est donc tout naturel pour les Guay d’aider son prochain parce qu’il y a eu du monde sur notre chemin de vie qui nous ont aidées. C’est un peu de redonner au suivant
, disent-elles.

Une femme anonyme confectionne un bijou avec des billes, du fil et une aiguille.
Photo : Radio-Canada / Magalie Masson
À lire :
Revenir aux sources
Pour mieux aider, elles se sont aussi réconciliées avec leur histoire et leurs racines innues.
Ce sont des personnes sur notre chemin qui nous ont aidées, à reprendre ma culture aussi. On m'avait dit : va vers ton peuple
, raconte Pénélope, qui a été élevée à l’extérieur de sa communauté autochtone. Adulte, elle a retrouvé la culture innue et s’est développé un intérêt marqué pour l’histoire.
C'est pour ça que j'enseigne l'histoire parce que moi, ça a été ma façon de comprendre ce que je vivais, de voir ma situation
, témoigne-t-elle.

Une femme manipule des petites billes colorées dans un plateau au centre d'hébergement.
Photo : Radio-Canada / Magalie Masson
Pour Nathalie, l’affirmation de soi passe par l’artisanat.
Moi, ce que j'aime enseigner, c'est l'artisanat, comment faire des mocassins, la façon de faire nos sacs, nos boucles d'oreille. Par cette identité, je transmets. Quand on fait de l'artisanat, on parle aussi de notre situation, on rit, on prend le temps
, soutient-elle.
Faire de l’artisanat, c’est se réapproprier nos façons de faire et personne ne peut nous enlever ça. Ils m’ont enlevé ma langue, ils m’ont enlevé ma communauté, ma famille, mais faire de l’artisanat, c’est l'identité. C’est même politique.
C’est pourquoi travailler auprès des femmes autochtones apparaît tout naturel pour les Guay.
Quand j'ai retrouvé ma culture, je n'avais pas le choix de revenir avec les femmes autochtones parce que c'est ma réalité et je la connais
, explique Pénélope.

Des capteurs de rêves sont suspendus à plusieurs endroits dans la maison Missinak.
Photo : Radio-Canada / Magalie Masson
Faire sa place en milieu urbain
Bien que Pénélope et Nathalie répondaient à un besoin en créant la première maison pour femmes autochtones à Québec, elles souhaitaient non seulement s'installer, mais s’intégrer dans la communauté.
On a travaillé vraiment fort, même avant la maison d’hébergement, on était déjà impliquées. Tout le milieu communautaire savait qu’on était autochtones. Dans les manifestations on était invitées à prendre la parole. Prendre sa place, ça veut dire s’intégrer, travailler en partenariat avec les non-Autochtones. La réconciliation, c’est être en action avec
, croit Pénélope.

Pénélope et Nathalie répondaient à un besoin en créant la première maison pour femmes autochtones à Québec
Photo : Radio-Canada / Magalie Masson
Des projets plein la tête
À 73 ans, Pénélope Guay commence à penser à déléguer certaines tâches. Pour elle et sa fille, ce n’est pas la fin, mais le début d’un nouveau chapitre. Elles travaillent sur la construction d’une maison d’hébergement pour hommes.
Tout le chemin qu’on a parcouru, c’est ensemble qu’on l’a fait. Si on n’avait pas eu d’amour, ça aurait été impossible
, dit Nathalie à sa mère, bien qu’elle appréhende son départ dans l’organisme… et dans sa vie.
C’est la plus grosse peine que je vais avoir quand elle va s’en aller
, avoue-t-elle.
Quand je ne serai plus là, je vais veiller sur toi!
, rappelle Pénélope en prenant le visage de sa fille.
Les deux éclatent de rire. Les Innus, peuple rieur
, portent bien leur surnom.
*Les noms de certaines femmes ont été modifiés afin de conserver leur anonymat.