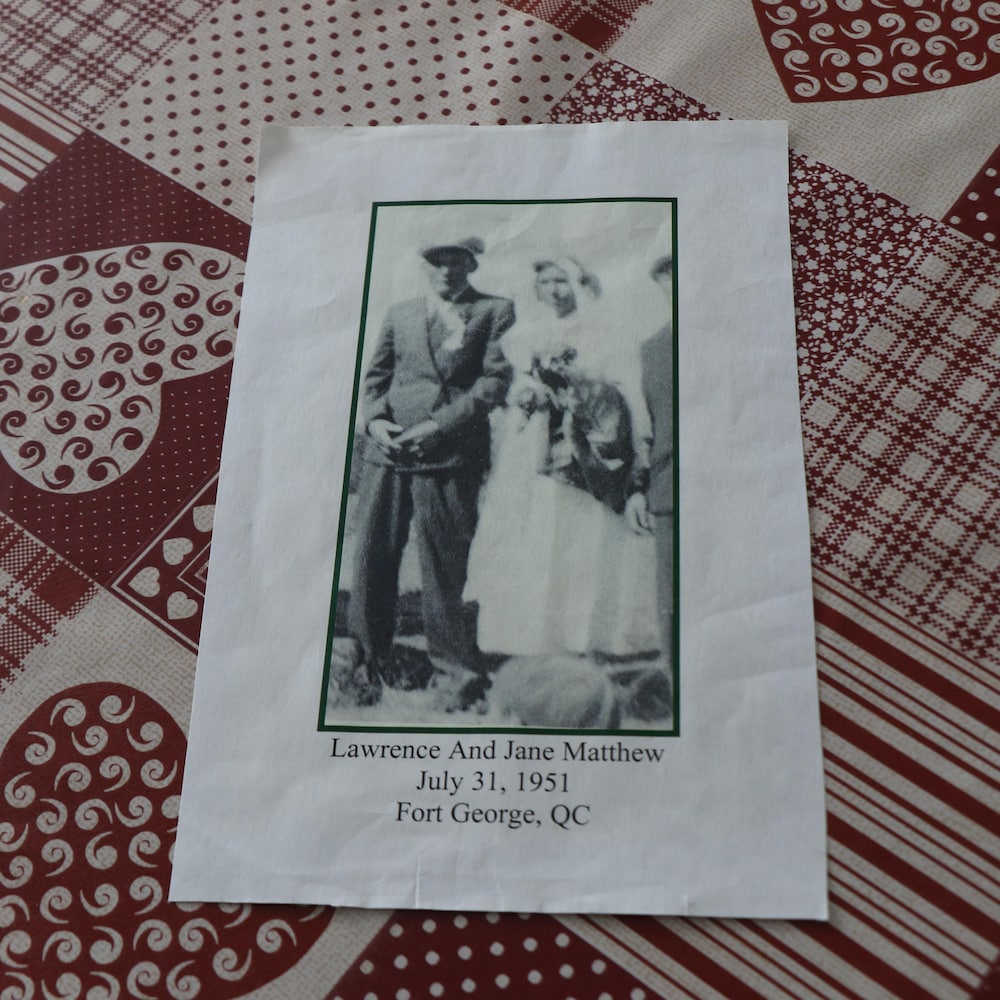Bandana rouge sur la tête, chemisier avec des fleurs brodées, Jane Matthew coud, bien assise dans le canapé beige de sa maison à Chisasibi, la plus grande communauté de la nation crie.
Jane Tapiatic, son nom à la naissance, est née très loin, près de Caniapiscau, à 800 kilomètres de Chisasibi, le 22 août 1932. L’endroit où elle a vu le jour n’existe plus, à cause des projets hydroélectriques.
Jane Matthew avait sept ans. Elle revenait de la pêche, le poisson était petit. Près d’un siècle plus tard, ses souvenirs sont encore très précis. Comme chaque année, la famille crie était à son camp à des centaines de kilomètres de l’île de Fort George.
Quelque part vers 1939-1940, la famille est sur le territoire. Sa mère revient avec du bois et interpelle la petite fille, seule, car son père et son frère sont partis chasser. Dans son temps, rappelle l’aînée en cri, il n’y avait ni docteur ni infirmière dans le bois. Il n’y avait qu’eux, les Cris.
C’était vraiment loin, il n’y avait personne proche du camp
, précise l’aînée. Sa mère lui demande alors de mettre de l’eau près du feu. Plongée dans les images qui défilent dans sa tête, elle rit.
Sa mère se glisse alors sur une fourrure de lièvre, lui demande d’accrocher les objets qui sont dans un petit sac. C’est là que j’ai su que le bébé allait arriver bientôt.
Car dans la culture crie, les femmes accrochent sur une corde devant elles des objets, des habits pour les aider, lors du travail, à visualiser le bébé.
« Il n’y avait pas de bruit. Ma mère s’est mise sur le côté… et puis elle avait le bébé dans ses mains. C’était très rapide. Il y avait encore de la neige sur ses mocassins. C’est la première fois que j’ai assisté à une naissance. J’avais sept ans! »
Ainsi ont commencé les premiers gestes de sage-femme de Jane Matthew. Comme sa mère qui a accouché 58 enfants dont un est encore en vie, les bras de Jane Matthew en ont accueilli, des bébés. Des gestes millénaires qu’elle a appris sur le tas.