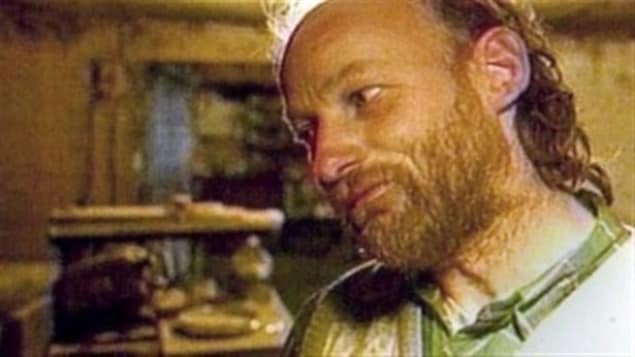- Accueil
- Société
- Mobilisation citoyenne
[Reportage] Campement propalestinien à McGill : « Nous avons un soutien inattendu »
Deux étudiantes latino-américaines de McGill se sont jointes au campement sur le terrain de leur université. De son côté, le professeur Alejandro Paz de l'Université de Toronto soutient les étudiants. Ils se sont entretenus avec RCI pour parler du mouvement et des revendications faites auprès de plusieurs universités canadiennes.

Un campement propalestinien s'est installé à l'Université McGill, en plein centre-ville de Montréal, le 27 avril dernier.
Photo : RCI / María Gabriela Aguzzi
Alors que les combats s'intensifient près de Rafah et dans le nord de la bande de Gaza, des étudiants de plusieurs universités canadiennes continuent de camper sur les terrains de différents campus « pour protester contre le génocide commis par l'État d'Israël à l'encontre du peuple palestinien », tel que l'a déclaré la Rapporteure des Nations unies Francesca Albanese. (nouvelle fenêtre)
Pour rester au courant des dernières nouvelles concernant le conflit au Proche-Orient, consultez notre couverture en direct (nouvelle fenêtre) et suivez notre dossier à ce sujet (nouvelle fenêtre).
Au Québec, un campement d'étudiants en solidarité avec le peuple palestinien de Gaza a été installé le 27 avril dernier sur le campus principal de l'Université McGill, dans le centre-ville de Montréal. Dimanche dernier, le 12 mai, un nouveau campement propalestinien a vu le jour au Complexe des sciences de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), situé dans le Quartier des spectacles, en plein cœur de la métropole.
Selon deux étudiantes d'origine latino-américaine de McGill, qui ont demandé à Radio Canada International (RCI) de ne pas révéler leurs noms, la manifestation se poursuivra jusqu'à ce que l'administration de l'université écoute leurs revendications.
Nos demandes ont été très claires : nous exigeons tout d'abord que le comité d'investissement de McGill divulgue tous les investissements dans des entreprises complices du génocide du peuple palestinien. Nous exigeons également la fin de tous les cours, stages et programmes d'échange avec Israël, qui normalisent la réalité violente du régime sioniste. Et nous demandons le désinvestissement des entreprises complices de l'occupation israélienne et du génocide palestinien, y compris les entreprises d'armement et de technologie
, explique une des étudiantes interrogées.
Les deux étudiantes, qui se sont entretenues avec RCI la semaine dernière, ont déclaré qu'elles étaient dans le camp depuis le premier jour et l'une d'entre elles a même indiqué qu'elle avait participé à l'organisation de la manifestation. Cette dernière a indiqué qu'elle a aussi des origines palestiniennes et que cela constitue un argument supplémentaire pour participer à la manifestation. Toutes deux ont souligné que leur participation à la manifestation était motivée par leur besoin de dénoncer le génocide à Gaza et de faire en sorte que McGill désinvestisse son argent
.
J'ai des racines palestiniennes. Cela m'a motivée encore plus à être active et consciente de tout ce dont nous avons besoin au sein de la communauté, à la fois à McGill et à l'extérieur [de l'université]. J'ai ce lien personnel. Mais au-delà de cela, je veux m'impliquer parce que je suis contre le génocide et ce que fait Israël.

Une pancarte à l'entrée du camp étudiant propalestinien à l'Université McGill, à Montréal. On peut y lire : « Il n'y aura pas de liberté tant que la Palestine ne sera pas libre. »
Photo : RCI / María Gabriela Aguzzi
Une partie du campement de l'Université McGill, qui comprend des étudiants et des professeurs de McGill et des membres d'autres universités québécoises, dont Concordia et Laval, est accessible à tous. Cependant, une clôture métallique a été installée pour protéger les tentes où dorment les manifestants. En périphérie, d'autres tentes offrent gratuitement de la nourriture et des produits de première nécessité.
Les deux étudiantes ont déclaré que l'atmosphère à l'intérieur du camp était généralement très bonne
, mais ont avoué que cela dépendait beaucoup de la météo. S'il pleut, tout est beaucoup plus difficile.
La communauté vient tous les jours pour nous soutenir. Cela nous aide énormément. Nous avons un soutien inattendu, surtout de la part de la communauté arabe de Montréal
, a dit l'une d’entre elles.
La manifestation comprend également des membres de la communauté juive de Montréal
, ont rappelé les deux étudiantes. Ils ont été présents pendant tout ce temps, parce que c'est un espace très sûr. Nous parlons d'une communauté très diverse. [Ceux qui y vont] sont des juifs antisionistes et ils assument le rôle de différencier le judaïsme du sionisme
, a indiqué l'une des jeunes femmes, tout en ajoutant qu'elle a passé plusieurs nuits à dormir dans une tente depuis l'installation du camp.
De plus, nous avons un groupe de professeurs de McGill qui nous ont toujours soutenus et ont toujours été là, en accompagnement
, a précisé l'autre étudiante.
Mobilisés indéfiniment
Les autorités du gouvernement du Québec et l'administration de l'Université McGill ont qualifié la manifestation d'illégale
. Le premier ministre de la province, François Legault, a demandé à la police de Montréal de démanteler les tentes peu après leur installation. Toutefois, M. Legault a indiqué la semaine dernière qu'il s'agissait d'une action qui relevait de l'université et des autorités policières.
En ce qui concerne les négociations avec l'administration de McGill, une des étudiantes rencontrées par RCI a déclaré qu'il y avait eu des conversations entre les deux parties. Il y a eu des négociations et nous avons exprimé nos demandes de manière très claire à l'université et à l'administration, mais ils n'ont proposé aucun plan concret pour qu'ils agissent et répondent à nos exigences
, a-t-elle mentionné.
Nous resterons ici jusqu'à ce qu'ils respectent nos demandes et les satisfassent. Le camp est pour l'instant indéfini. Nous n'avons pas l'intention de bouger tant qu'ils n'auront pas proposé un plan concret et tant qu'ils n'auront pas désinvesti à 100 %.
Cependant, les avocats de l'université montréalaise ont saisi les tribunaux pour obtenir une injonction (nouvelle fenêtre) afin de démanteler le campement propalestinien qui se trouve sur son campus du centre-ville depuis le mois dernier. Dans une requête datée du vendredi 10 mai, l'Université McGill affirmait que le camp constituait un risque pour la santé et la sécurité publique et qu'il aggravait les tensions sur le campus.
Cette demande d'injonction a été rejetée par la Cour supérieure du Québec mercredi.
Au-delà du 7 octobre
Lors de leur entrevue la semaine dernière, les deux étudiantes ont été interrogées sur leur point de vue concernant les événements du 7 octobre lorsque le Hamas a lancé une attaque surprise sur Israël qui a fait 1200 morts et 240 otages. Nous sommes ici parce que cela dure depuis plus de 76 ans. Tout cela va au-delà du 7 octobre,
a noté l'une d'elles. Il s'agit d'une occupation de 76 ans
, a ajouté l'autre étudiante.

Photo d’une partie de l'entrée du campement étudiant en solidarité avec la Palestine à l'Université McGill, au centre-ville de Montréal, le 9 mai 2024.
Photo : RCI / María Gabriela Aguzzi
Selon le ministère de la Santé du Hamas, plus de 35 000 Palestiniens ont perdu la vie dans la bande de Gaza, principalement des femmes et des enfants, depuis qu'Israël a déclaré la guerre au Hamas et lancé son offensive le 7 octobre. Par ailleurs, plus de 78 404 personnes ont été blessées en territoire palestinien.
Le ministère de la Santé du Hamas est la seule source officielle de données sur les victimes dans la bande de Gaza, Israël ayant fermé les frontières de la région, empêchant non seulement les journalistes étrangers, mais aussi les travailleurs humanitaires d'y pénétrer.
À Gaza, environ 160 enfants meurent chaque jour, soit un toutes les 10 minutes
, a déclaré Christian Lindmeier, porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en novembre dernier.
Le 5 mai, le gouvernement du premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a ordonné la fermeture de la chaîne d'information Al Jazeera en Israël et la confiscation de son matériel tant que la guerre à Gaza se poursuivra.
Un mouvement de longue date
Des étudiants propalestiniens ont également installé des campements sur le terrain d'autres établissements d'enseignement au Canada, notamment à l'Université de Toronto, à l'Université d'Ottawa et sur le campus de l'Université de Colombie-Britannique (UBC) à Vancouver. L'Université du Manitoba, dans le centre du pays, s'est jointe au mouvement le 7 mai.
Radio Canada International s'est entretenu avec Alejandro Paz, professeur d'anthropologie à l'Université de Toronto. Il a déclaré que ces camps représentent une forme de manifestation non violente contre ce qui se passe dans la bande de Gaza. Selon lui, il s'agit d'un mouvement qui s'est construit au fil des ans.

Alejandro Paz est professeur d'anthropologie à l'Université de Toronto.
Photo : RCI / Captura de pantalla - María Gabriela Aguzzi
Les étudiants disent que c'est le seul moyen de faire pression, de faire une forme de résistance non violente. N'oublions pas que l'appel initial du mouvement BDS (Boycott, Désinvestissement et Sanctions) date de 2005. Ce mouvement a une histoire, une tradition au sein de la lutte palestinienne pour la libération, qui est une lutte juste
, fait remarquer M. Paz, dont les publications et les travaux en cours sont fondés sur un travail de terrain ethnographique, archivistique et linguistique en Israël/Palestine
, peut-on lire sur le site web de l'Université de Toronto.
Le mouvement BDS est mené par des Palestiniens pour la liberté, la justice et l'égalité et défend le principe selon lequel les Palestiniens ont les mêmes droits que le reste de l'humanité
, peut-on lire sur le site du mouvement.
Cet appel au BDS a été lancé par de nombreuses organisations palestiniennes et par la société civile. Les Palestiniens ont été expulsés et exilés en 1948 et l'État d'Israël s'est emparé de leurs biens. Tout a été détruit. Les Nations unies ont même adopté une résolution accordant le droit au retour aux exilés palestiniens et, 76 ans plus tard, nous attendons toujours le moment où cette justice historique pourra être réconciliée. Il ne s'agit donc pas d'une invention d'étudiants universitaires datant d'un mois, mais d'un mouvement qui existe depuis de nombreuses années.
M. Paz, dont la femme est israélienne, soutient les étudiants du camp et suit de près l'évolution de la manifestation à Toronto. Les étudiants négocient avec l'administration de l'université, car depuis de nombreux mois, ils voient ce qui se passe dans la bande de Gaza et ils constatent un génocide
, a-t-il affirmé.
Les revendications des activistes de l'Université de Toronto sont les suivantes :
1. désinvestir la dotation de l'université, ses actifs et autres avoirs financiers de tous les investissements directs et indirects qui soutiennent l'apartheid israélien, l'occupation et la colonisation illégale de la Palestine;
2. divulguer tous les investissements réalisés dans la dotation de l'université, les actifs à court terme et les autres avoirs financiers par la suite;
3. mettre fin à tous les partenariats avec des institutions universitaires israéliennes qui opèrent dans des colonies illégales en Palestine occupée ou qui soutiennent les politiques d'apartheid de l'État d'Israël et son génocide à Gaza.

Le campement propalestinien à l'Université de Toronto
Photo : La Presse canadienne / Christopher Katsarov
Selon le professeur d'anthropologie, il y a une complicité avec ce que fait l'État d'Israël
aux yeux des étudiants, d'où la grande participation des militants à ce campement, qui ne se limite pas aux étudiants de l'Université de Toronto, mais aussi aux professeurs de cette même université, ainsi que des universités McMaster, Wilfrid-Laurier, de Windsor et, plus récemment, de l'Alberta.
Le camping n'est pas une activité facile pour de nombreux étudiants, qui doivent également travailler, car beaucoup d'entre eux n'ont pas beaucoup de ressources
, a rappelé Alejandro Paz.
Beaucoup d'entre eux font des efforts considérables. Ils doivent travailler. J'ai vu de nombreux étudiants arriver au camp et dire qu'ils devaient partir à 22 h parce qu'ils devaient travailler le soir. Ce n'est pas facile, ce n'est pas agréable, mais en même temps ils sentent une communauté, un effort collectif, ce qui est très important. Et ils comprennent qu'ils font partie d'un mouvement beaucoup plus large [...]. Ce qui se passe dans la bande de Gaza est une horreur.
Des revendications qui peuvent être satisfaites
Selon Alejandro Paz, il est possible de répondre aux demandes des étudiants, ajoutant que d'autres universités ouvrent des comités pour enquêter sur ce qui se passe, notamment les universités Rutgers (New Jersey, États-Unis), l'Université Brown (Rhode Island, États-Unis), Goldsmiths (Royaume-Uni) et Thompson River (Canada).
Ils réfléchissent tous à la manière d'y parvenir, parce qu'en fin de compte, c'est la bonne chose à faire pour parvenir à un avenir où les Palestiniens et les Israéliens pourront vivre ensemble. Nous n'avons pas le choix. Il est très important de trouver des moyens non violents de parvenir à cet avenir
, a-t-il dit.
Le professeur d'anthropologie pense que ce type de manifestation fait également partie de ce que représente une université. L'université, ce n'est pas seulement étudier et recevoir un diplôme. Ce n'est pas seulement faire des dissertations pour la fin du semestre. C'est un espace où l'on réfléchit, de manière démocratique, aux changements dont le monde a besoin et à la manière dont nous allons les réaliser.
Alejandro Paz affirme qu'un sentiment de communauté régnait dans le camp et que des membres de la communauté juive de Toronto participaient également aux activités. Le vendredi 3 mai, par exemple, nous avons célébré le sabbat avec le Cercle du peuple pour la Palestine, tous ensemble.
En ce qui concerne les événements du 7 octobre, M. Paz estime qu'il s'agit d'un événement horrible
.
C'est pourquoi je pense que le BDS est une voie à suivre. Si vous n'aimez pas ce qui s'est passé le 7 octobre, le BDS est un moyen. Deux cousins de mon beau-père ont été enlevés. L'un d'entre eux a déjà été libéré, mais pas l'autre. C'est quelque chose de très proche de ma famille et c'est très douloureux [...]. Je ne le voyais pas avant, mais surtout après le 7 octobre : je ne vois pas un avenir basé sur des politiques d'apartheid, sur la poursuite de la répression militaire, sur l'incroyable violence militaire qui est nécessaire pour maintenir l'État d'Israël comme un État qui considère les citoyens juifs comme suprêmes, avec plus de droits que les autres. C'est un régime extrêmement impitoyable.
Nous savons, grâce à de nombreux contextes latino-américains, que lorsqu'un régime est imposé avec une telle brutalité, on reçoit également de la brutalité. Nous pouvons penser à de nombreux mouvements de guérilla au cours du 20e siècle et à certains qui se poursuivent encore aujourd'hui, qui sont arrivés à la conclusion, après avoir subi une répression militaire, que seules les armes leur permettraient de se défendre
, a-t-il conclu.
Ce reportage est également disponible en espagnol
À lire aussi :
- Les manifestants propalestiniens pourront demeurer sur le campus de McGill
- L’UdeS assure avoir une bonne communication avec les membres du campement propalestinien
- L’UQAM occupée à son tour par un campement propalestinien (nouvelle fenêtre)
- Une semaine de campement à l’Université de Toronto : « On est ici à long terme » (nouvelle fenêtre)